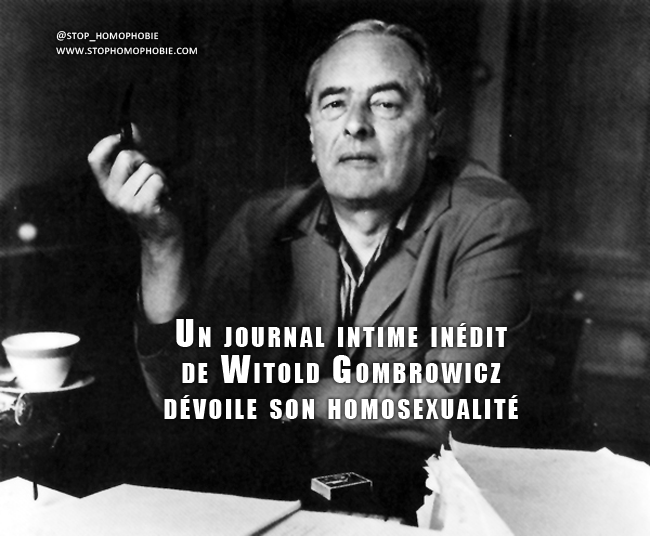Regarde la trace de mes doigts poisseux partout sur la page, j’ai mangé des pêches.» Faites un choix irréversible: n’ouvrez plus vos mails non-poétiques, mettez de côté les pages culturelles du Monde, fermez le dernier livre à succès du moment et, dans votre fauteuil, au coin du feu, prenez dans vos mains la correspondance entre Vita Sackville-West et Virginia Woolf.
C’est sans doute la plus parfaite des lectures hivernales, destinée à tous ceux qui cherchent une alternative aux actualités focalisées sur les fêtes de fin d’année. Il ne s’agit pas seulement d’une subtile correspondance amoureuse (plus de cinq cents lettres de 1922 à 1941), mais aussi d’un manuel d’étiquette de l’amour littéraire, snob et libre, brodé d’un lexique métaphorique faisant souvent référence aux petits animaux dont l’une et l’autre avaient l’habitude de s’accompagner: Potto n’est pas seulement le petit chien de Virginia[1], c’est aussi le nom qui désigne ce que, en Virginia, appartient secrètement et pour toujours à Vita.
Page après page, le lecteur ne peut que remarquer l’évidente infériorité de la postmodernité par rapport à la modernité: les lettres expédiées de Londres arrivent à Berlin le lendemain; le téléphone n’est employé que pour les urgences, puisqu’il n’est pas considéré convenable pour une véritable conversation polie; une jeune femme peut partir seule de Berlin avec son automobile pour arriver, si elle le veut, en Perse; le mariage permet plus de chose qu’il n’en interdit…
Quand Vita rencontre Virginia, à un dîner chez Clive Bell, son beau-frère, elle est une écrivaine renommée (elle vend plus de livres que Virginia Woolf). Élégante, charmante et aristocratique, elle n’est pas très belle mais elle voyage (Rapallo, Istanbul, Rabat, Potsdam, Berlin) et elle a déjà provoqué –séduisant parfois le mari, parfois la femme– plusieurs divorces (entre autres, celui de Geoffrey Scott et de Violet Tréfusis, dont on pourra lire la belle correspondance).
Virginia, de son côté, a peut-être déjà désiré un amour saphique, dans le cas de Magda Vaugham et de Violet Dickinson, mais jamais après son mariage avec Léonard, un lien qui la porta loin de la mondanité londonienne qui avait entouré son enfance à cause de sa mère Julia, disparue très tôt, et dont la beauté avait été immortalisée par les plus célèbres des préraphaélites.
Vita est frappée par la pureté et la fragilité de Virginia: dès le jour de leur rencontre, elle lui écrit des lettres très émouvantes et maladroites, qu’elle cède tout au long de sa vie à la maison d’édition de Virginia, la Hogarth Press. Et puisque Vita est une excellente correspondante, et comme ses lettres sont plus généreuses, plus piquantes, plus riches en mondanités, en paysages inspirés (ce n’est pas par hasard si on peut encore visiter son jardin de Sissinghurst, ou lire les conseils de jardinage qu’elle publia chaque semaine dans The Observer), Virginia quitte volontiers sa timidité pour se laisser modeler, physiquement et psychologiquement, par sa nouvelle amie, dont elle devient la maîtresse une nuit de décembre 1925 quand Vita la kidnappe d’une clinique pour l’emmener dans sa demeure de Long Barn : «Un orage à Vézelay et les plafonds de Long Barn vacillant doucement tout à l’alentour.» Les lettres de cette période sont enchantées, joyeuses, heureuses, et c’est comme si l’une et l’autre arrivaient à retrouver, habiter, protéger les lieux et le temps de leurs enfances.
C’est dans une page de son journal, datée du soir du 5 octobre 1927, que Virginia note son inquiétude à propos de l’éloignement de Vita. En effet, quatre jours plus tôt, Vita a accueilli chez elle, à l’insu de son amie, la belle Mary Campbell. Alors, c’est à Virginia de modeler Vita. Elle choisit tout naturellement la littérature. Le 6 octobre, trois jours avant de recevoir une lettre de Vita lui demandant pardon, elle commence la rédaction d’Orlando, roman symbole de sa passion pour Vita et, en même temps, acte douloureux et mélancolique qui marque sa fin. Orlando raconte l’histoire d’un jeune adolescent de l’Angleterre élisabéthaine (1586), qui parcourt trois siècles d’histoire (jusqu’en 1928). Il est tour à tour jeune lord, ambassadeur en Turquie, appartient à une tribu de bohémiens, puis retourne vivre sous les traits d’une femme de lettres dans l’Angleterre victorienne. Virginia conçoit la publication enrichie de quelques photos de Vita, de ses ancêtres, de la magnifique résidence familiale (elle s’inspire de l’essai de Vita, Knole and the Sackwilles) dont Vita n’a pas hérité car elle n’est pas un garçon.
Orlando, magnifiquement subversif dans sa forme comme dans son contenu, est un succès, et Vita, qui ne pourra le lire avant le jour de sa publication, en est charmée. Leur correspondance continue, moins fréquente, ainsi que leurs rendez-vous, leurs discussions sur le rôle de la femme en société (Orlando sortit pendant le procès fait au volume de Radclyffe Hall, The Well of Loneliness), sur la guerre et surtout sur la littérature («Comment se fait-il que les romans de nos jours soient si abominablement idoines avec tout juste autant de vie en eux qu’un poisson expirant?»), jusqu’à la dernière lettre de Virginia, trois jours avant son suicide, le 28 mars 1941, les poches remplies de cailloux, dans l’Ouse.
En l’absence d’un appareil critique –notes très rares, pas de bibliographie, des préfaces qui remontent à la première édition– le lecteur peut plonger ultérieurement dans l’essai de Suzanne Raitt, Vita and Virginia. The Work and Friendship of Vita Sackville-West and Virginia Woolf [2], qui souligne l’influence réciproque entre les deux écrivaines, ou alors en lisant le reste de la correspondance de l’auteur de To the Lighthouse parue en 2009 [3] et en 2010[4].
Il est émouvant de lire la passion que Virginia déploie pour essayer sa nouvelle cabriolet dans les Alpes ou pour empaqueter à la main tous les nouveaux livres de sa maison, ou l’énergie que Vita déploie pour rebâtir ailleurs la maison d’enfance qu’on lui avait volée lors de l’héritage, ou alors la voir chevaucher en culottes jusqu’au coucher du soleil ou griller son pain sur le chauffage de la chambre de son amie ou acheter des tickets de train de seconde classe pour éviter ceux qui «sentent toujours l’eau de Cologne, ce qui me donne mal au cœur», ou partir avec Virginia pour visiter la maison natale de Keats ou pour faire les vendanges en Bourgogne, ou l’écouter quand elle interrompt sa traduction de Rilke pour décrire, à une femme chérie, plus âgée de dix ans, ce qui entoure sa petite feuille: «Je suis assise sur un balcon dominant un lac aux eaux noires que bordent des saules pleureurs […]. Un peu plus loin, entre les arbres, se devine une ruine romantique […]. Je vois [les enfants qui partent en promenade] et qui diminuent de volume à mesure que leur petit bateau les entraîne plus loin sur le lac» (p. 431).
Erika Martelli
[1] Sur qui Maureen Adams écrit dans Shaggy Muses, Chicago University Press, 2007 ; Virginia Woolf écrivit une biographie ironique, Flush, sur le petit chien d’Elizabeth Browning Barrett, en 1940, certes en dehors des canons établis par son père, Leslie Stephen, dans le Dictionary of National Biography. Retourner au texte.
[2] Clarendon Press, Londres, 1993. Retourner au texte.
[3] Edition de L. Woolf. Retourner au texte.
[4] Edition de N. Nicolson. Retourner au texte.
http://www.slate.fr/tribune/81661/plus-longue-charmante-lettre-amour-litterature