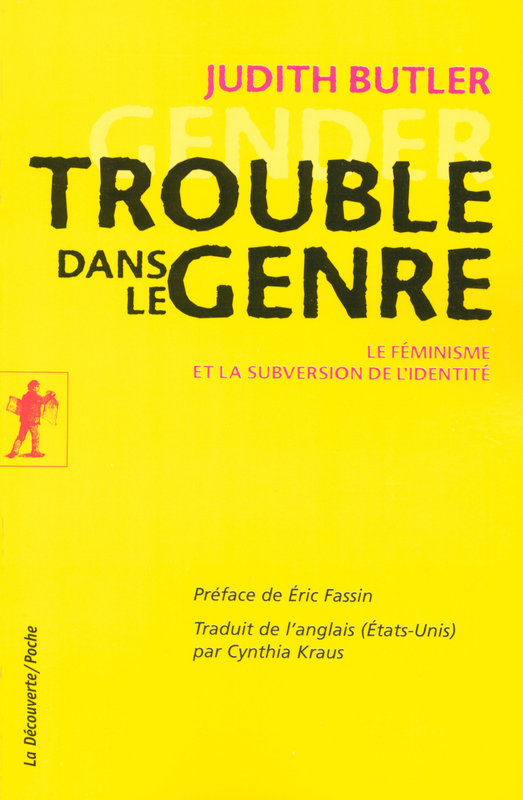Depuis les polémiques sur les manuels de SVT en 2011, la mise en cause des études de genre a été de plus en plus fréquente sur les réseaux cathos, et est particulièrement présente depuis le début de la polémique sur la mariage gay. Ainsi on voit circuler en boucle un documentaire norvégien dont on soutient qu’il aurait conduit le gouvernement de ce pays à bannir des études de genre (ce qui est faux), le site d’un « observatoire de la théorie du genre », ou encore une page facebook qui sous-entend un lien entre la genèse des études de genre et des tentatives de légitimation de la pédophilie.
En réaction, certains blogueurs catholiques tentent de défendre ces études de genre, et combattre ce qui leur parait être des caricatures et des contre-sens, ainsi Anthony Favier, Baroque et fatigué, ou, à un niveau beaucoup plus débutant, moi-même.
Et en réaction à la réaction, si je puis dire, on constate un certain nombre de tentatives pour trouver un « juste milieu », qui visent à démontrer les limites supposées de la « théorie du genre » sans attaquer de manière trop globale et sommaire un champs de recherche universitaire dans son ensemble. l’idée serait de dénoncer les implications politiques (notamment la remise en cause du modèle familial traditionnel) tout en reconnaissant la légitimité de certaines intuitions centrales (qu’une « certaine » part de notre perception de la différence des sexes est construite, et potentiellement source d’inégalités).
L’objet de cette série de billets est de parcourir ces objections « modérées » aux études sur le genre, afin de tenter d’y répondre. Dans le premier, je reviendrai sur la querelle nature vs culture, et de la prédilection de la plupart des observateurs catholiques avec qui j’ai pu discuter pour le « juste milieu » d’une conception de la différence des sexes qui serait en partie construite, et en partie biologique, et dans le second, sur la question des revendications plus proprement liées à la situation des transexuels, transgenres et intersexués, qui semblent cristalliser la plupart des craintes, et justifier aux yeux de certains le rapprochement avec les questions éthiques soulevées par le mouvement transhumaniste. Puis j’écrirai probablement d’autres volets en nombre indéterminé, suivant les objections que je repèrerai ou qui me seront faites directement.
A force de lire les billets et les statuts de divers catholiques en lien avec les études de genre, j’en retire que l’une des difficultés majeures qu’elles soulèvent à leurs yeux est qu’ils n’en voit pas vraiment l’intérêt ni l’originalité. Qu’il y ait une influence de certaines conventions sociales sur les attributions traditionnelles de chaque sexe, que par exemple la coutume suivant laquelle les filles portent des robes et des cheveux longs et les hommes des pantalons et des cheveux courts soit d’origine sociale et non biologique, c’est une éévidence que même l’intégriste le plus obtus concèderait sans difficultés aucunes, à moins d’avoir de lui même de sérieux problèmes avec la réalité. A l’inverse, qu’il n’y ait aucune influence biologique de la différence sexuelle, par exemple une moins grande force physique, en moyenne, des femmes, cela parait là encore une évidence que seuls la coquetterie intellectuelle ou le militantisme aveugle songeraient sérieusement à remettre en cause.
Dans les termes d’un avis du Conseil Scientifique du CLER Amour et Famille paru en novembre 2011 et intitulé La controverse du Gender:
« C’est une vision néo-marxiste de la différence sexuelle, qui relève de la dialectique bourreau / victime, que de lire obligatoirement cette différence comme une inégalité qui oppose et suscite des antagonismes et qui désigne l’homme comme l’oppresseur et la femme comme la victime. Que cette différence puisse conduire à l’exercice d’une domination de l’homme sur la femme n’est pas discutable, mais cette domination n’est pas l’apanage de l’homme et la domination féminine existe aussi. La réalité est surtout que cette différence n’est pas seulement un écart mais qu’elle comporte aussi des convergences, des correspondances, des affinités qui créent de la complémentarité, source d’admirables harmonies.
D2. LE REFUS DE LA DIFFERENCE SEXUELLE COMME FONDEMENT DU GENRE (LE SEXE PROPREMENT DIT N’EST UTILE QUE POUR LA REPRODUCTION).
La réalité biologique des sexes n’est pas « neutre » au début, comme l’ont affirmé, contre toute évidence, certains théoriciens du gender qui pensaient qu’il suffisait ensuite de la modeler dans un sens masculin ou féminin (en vérité plutôt incertain) par l’influence socio culturelle.
Il est au contraire montré que le cerveau humain est modelé dès avant la naissance par des facteurs génétiques et épi-génétiques (en particulier hormonaux) qui orientent les sujets vers des types masculins ou féminins aux caractéristiques statistiquement observables.
Cette réalité biologique représente alors un axe solide autour duquel se constitue, en conjonction avec un contexte culturel donné, la psychologie de l’individu sexué qui participe de l’identité personnelle.
L’ancrage biologique dans la construction identitaire signifie une certaine relation du sujet à son corps, une appropriation de celui-ci, qui passe par le consentement à ses potentialités comme à ses limites. Il y a également une symbolisation à partir du vécu sexuel féminin ou masculin qui débouche sur une différence dans la manière de désirer, de jouir, d’enfanter … Les représentations symboliques sexuelles jouent un rôle primordial dans la construction de la personnalité, de la personne intérieure.
L’esprit humain se forme à partir du corps. Si le corps humain est différent entre les sexes comment l’esprit ne le serait-il pas (on n’a pas la même vision du monde quand on mesure 1,90 m et pèse 100 kg, que quand on mesure et pèse deux fois moins). Pourquoi serait-ce différent a priori pour la différence sexuelle ?
Refuser la référence à la différence sexuelle, qui est une différence d’abord inscrite dans le corps (anatomique, hormonale, neurocérébrale…), est une forme de refus du corps aboutissant à une vision imaginaire et irréelle de la condition humaine. Considérer alors que l’identité de genres est de construction essentiellement socioculturelle c’est concevoir une identité personnelle indistincte et fragile, gouvernée par la seule subjectivité. »
En premier lieu, cet extrait appelle deux remarques de détail sur la présentation qu’il donne des affirmations des études de genre et des contre-arguments quil leur oppose:
1ère remarque: attribuer à une influence « néo-marxiste » l’interprétation de la conception « habituelle » des rapports hommes-femmes comme d’une construction sociale traversée par des rapports de pouvoir et qui asure de fait la domination d’un sexe sur le second simplifie trop, et donne une image trop unilatérale et sommaire, des ramifications politiques des études de genre. Pour prendre l’exemple de Butler, dont la discussion des thèses constitue une partie importante de cet avis, c’est plus classiquement sur la dialectique maître/serviteur exposée par Hegel dans La phénoménologie de l’esprit, et sur la question de la reconnaissance, qu’elle s’appuie pour tenter de comprendre les relations de pouvoir qui traversent les rapports sociaux, et entre autres, ceux entre sexes. Il convient à cet effet de rappeler que sa thèse de doctorat de 1987, qui a été retravaillée et éditée en 1987 sous le titre Sujets du désir. Réflexions hégéliennes en France au XXe siècle portait, comme son nom l’indique, sur les lectures en France de l’oeuvre de Hegel au 20ème siècle: les exégèses (Kojève, Hyppolite), les réappropriations (Sartre) et les critiques (Deleuze, Lacan, Derrida, Foucault).
« L’analyse de la section « la vérité de la conscience de soi » [dans la Phénoménologie de l’Esprit] insiste sur le contexte dans lequel émerge le désir, ce qui permet d’emblée d’associer désir et constitution du sujet. En effet, le désir intervient comme thème central pour résoudre le dilemme propre à la conscience et au présupposé d’une altérité radicale à l’égard du monde. Le désir réalise le passage de la conscience à la conscience de soi et assure, de ce fait, l’émergence du sujet. En effet, c’est à travers le désir que le monde sensible devient une expérience pour la conscience de soi. Le désir apparaît à la fois comme intentionnel et comme réflexif : il vise toujours un objet et il est une « manière pour le sujet de se découvrir et de se renforcer à la fois » (p. 48). On passe d’une différence extérieure à des différences internes. « Le désir apparaît comme une synthèse de mouvement d’altérité ». Le sujet se reconnaît comme puissance de nier. […]
L’analyse de « domination et servitude » permet de faire le point sur l’emballement du désir et sur sa sophistication, ce qui revient à comprendre la « suppression » du désir, caractéristique de cette section, comme sa modification profonde. Le désir ne peut pas saisir la vie en générale et il a besoin d’une infinité d’objets pour rester vivant. Mais dans la perspective d’une inclusion plus grande de ses buts intentionnels, c’est l’Autre, autrui, qui apparaît comme l’objet du désir. On passe alors de la conscience de soi comme Désir général à la conscience de soi comme Désir particulier qui trouve sa satisfaction dans la Reconnaissance médiée par le travail du monde. On passe d’un sujet émergent à un sujet historique qui implique l’intersubjectivité.
Le désir est donc le processus qui assure l’émergence et la confirmation du sujet dans la reconnaissance ; elle assure une explication de lui-même comme puissance de nier. Le désir est en outre présenté comme structurant pour l’ensemble du projet de la Phénoménologie même s’il n’intervient qu’à partir de la section intitulée « la vérité et la certitude de soi-même » et qu’il est « supprimé » (aufgehoben) dans « domination et servitude ». « Parce que le désir est le principe de la réflexivité ou de la différence intérieure de soi et parce qu’il a comme but ultime l’intégration de toutes les relations extérieures dans des relations de différence intérieure, le désir forme la base expérimentale de ce projet d’ensemble de la Phénoménologie » (p. 69 ; c’est moi qui souligne) et « la sophistication du désir – l’inclusion de plus en plus large de ses buts intentionnels – constitue le principe du progrès dans la Phénoménologie » (p. 70).
Le lien entre le désir et le négatif est manifeste. Mais, c’est plus généralement la positivité du négatif et de la négation qui se fait jour et sur quoi insiste J. Butler : « le négatif est toujours et seulement utile – il n’est jamais une source d’affaiblissement définitif » (p. 44) ; « le négatif est aussi la liberté humaine, le désir humain, la possibilité de créer de nouveau. (…) Le non-actuel est en même temps le royaume du possible » (p. 89).[…]
Lire Hegel en philosophe, ce que s’attache à faire J. Butler, c’est d’abord rompre avec un certain héritage – celui qui en ferait le représentant des philosophes de la conscience défendant l’autonomie et l’autosuffisance – pour retrouver le traitement singulier qu’il propose du négatif et la prise en compte de la fragilité intrinsèque du sujet, ce qui constituera la matière de la réflexion future de l’auteure. Lire Hegel en philosophe, cela consiste aussi à prendre en compte la philosophie post-hégélienne et notamment la critique à l’égard des notions de sujet et de désir.
Au terme de ce parcours critique, l’objectif que se donnait J. Butler au départ se trouve rempli : « retracer la dernière étape de la querelle de la philosophie avec l’impulsion vive, avec l’effort philosophique pour domestiquer le désir et en faire un modèle de la situation métaphysique (de l’homme), avec la lutte qui conduit à accepter le désir comme principe de dislocation métaphysique et de dissonance psychique, et l’effort pour déployer le désir en vue de disloquer et de faire échouer la métaphysique de l’identité » (p. 36), ce qui s’avère rigoureusement opposé à la relation constitutive que permettait le désir dans le contexte de la Phénoménologie, sans pour autant défendre une métaphysique de la présence et de l’identité. Le désir hégélien est à la fois destructeur et constructeur, il est constitutif pour un sujet qui s’éprouve aussi dans la fragilité et qui n’a rien de l’autonomie et de l’autosuffisance que les critiques françaises lui ont attribuées.[…]
Paradoxalement, c’est en effet dans sa lecture du texte hégélien que J. Butler forge la notion de vulnérabilité qui est le concept fondateur pour une rénovation de la reconnaissance sur de nouvelles bases. La notion de vulnérabilité, la critique de l’autonomie et de l’autosuffisance prêtées à tort au sujet hégélien fonde les bases d’une critique de la reconnaissance hégélienne et assure l’élaboration de l’un des concepts clé de la pensée butlerienne.
Sujets du désir s’avère un ouvrage important dans la constitution de la pensée butlerienne. S’il apparaît « limité » en 1999, il trouve une dimension fondatrice en regard des derniers travaux. L’œuvre de J. Butler se présente donc comme une incessante relecture de Hegel, comme une évolution incessante à l’égard de cette œuvre. Cet ouvrage nous permet de comprendre comment aujourd’hui encore la lecture et la relecture critique d’un auteur peut fonctionner comme un outil heuristique et constitutif d’une philosophie originale et critique de son actualité. » (Actu Philosophia, Judith Butler : Sujets du désir Réflexions hégéliennes en France au XXe siècle, compte-rendu de lecture par Sandrine Alexandre).
Bien loin d’être une apologiste de la toute puissance du désir et de la subjectivité, comme certains persistent à l’affirmer, Butler est donc une penseuse de leur vulnérabilité. Je débute dans la lecture de son oeuvre, mais il me semble commencer à y discerner une unité, entre les premières oeuvres sur le genre et la situation des minorités sexuelles, et les plus récentes qui réfléchissent sur la précarité des vies humaines exposées à la guerre, à la torture et au deuil, dans le contexte de l’après-11 septembre, du conflit israelo-palestinien et des guerres en Irak et en Afghanistan, dans la réflexion sur les vies invivables, les corps qui ne sont pas reconnus comme tels, les souffrances qui ne sont pas pleurées. Bien loin d’être une utopiste, je discerne (à mon niveau de connaissance certe excessivement débutant) dans sa pensée un fond finalement assez sombre et désenchanté.Et loin de nier la matérialité des corps, elle cherche à comprendre pourquoi certains sont valorisés (les corps qui répondent aux normes de « l’hétérosexualité obligatoire », et d’autres qui sont considérés comme « invivables » ou tout simplement rejetés dans « l’impensable » et « l »abjection »: les trans, les intersexués, etc.).
2ème remarque: ce passage de l’avis du CLER que je commente semble tenter d’opposer les acquis des sciences « dures » au volet SHS des études de genre. Les auteurs semblent ne pas avoir repérer les ravaux de diverses biologistes acquises aux conclusions des études de genre, qui remettent en cause un certain nombre des « faits » scientifiques sur lesquels ils s’appuient. Ainsi:
» Il est au contraire montré que le cerveau humain est modelé dès avant la naissance par des facteurs génétiques et épi-génétiques (en particulier hormonaux) qui orientent les sujets vers des types masculins ou féminins aux caractéristiques statistiquement observables. »
Cette affirmation est contestée par des neuro-biologistes, ainsi Catherine Vidal en France, qui soutient que si cela est vrai pour cequi concerne le contrôle de la reproduction sexuelle, seulement 10% du cerveau est formé à la naissance, et que sa plasticité extraordinaire le rend très adaptable aux stimulis extrieurs, y compris aux conditionnements sociaux. insi, certaines différences observables entre un cerveau féminin et un cerveau masculin sont, paradoxalement, davantage le fruit de déterminismes sociaux que biologiques:
« Peut-on parler de cerveau féminin et de cerveau masculin ?
Catherine Vidal – La réponse scientifique est oui et non. Oui, parce que le cerveau contrôle les fonctions associées à la reproduction sexuée, qui sont évidemment différentes chez les femmes et chez les hommes. Chez la femme, on trouve des neurones qui ont des activités périodiques pour déclencher l’ovulation, ce qui n’est pas le cas chez l’homme. Mais concernant les fonctions supérieures du cerveau – les fonctions cognitives comme l’attention, la mémoire, le raisonnement – c’est la diversité cérébrale qui règne indépendamment du sexe. Grâce aux nouvelles techniques d’imagerie cérébrale comme l’IRM, on a pu montrer que les différences entre les individus d’un même sexe sont tellement importantes, qu’elles dépassent les différences entre les deux sexes. Cette variabilité s’explique par les extraordinaires propriétés de « plasticité » du cerveau, c’est-à-dire sa capacité à se modifier en permanence en fonction de l’apprentissage et l’expérience vécue. A la naissance seuls 10% de nos 100 milliards de neurones sont connectés entre eux. Les 90% des connexions restantes vont se construire progressivement au gré des influences de la famille, de l’éducation, de la culture, de la société.[…]
Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles techniques d’exploration du cerveau sont apparues. C’est ce qu’on appelle « l’imagerie cérébrale », en particulier l’IRM. On peut désormais voir un cerveau vivant en train de fonctionner.
Il s’agit donc d’une révolution dans les méthodologies, et par conséquent d’une révolution dans les concepts du fonctionnement du cerveau. On a découvert des choses qu’on n’imaginait pas auparavant. En particulier, on a mis à jour ces propriétés extraordinaires qu’on appelle la « plasticité cérébrale » qui font que le cerveau se fabrique en permanence des circuits de neurones, en fonction de l’apprentissage et de l’expérience vécue. Rien n’est jamais figé dans le cerveau. Cette variabilité s’explique par les extraordinaires propriétés de « plasticité » du cerveau, c’est-à-dire sa capacité à se modifier en permanence en fonction de l’apprentissage et l’expérience vécue. Ainsi, chez les pianistes, on observe un épaississement des régions du cerveau spécialisées dans la motricité des doigts, dans l’audition et la vision. Et ces changements sont directement proportionnels au temps consacré à l’apprentissage du piano pendant l’enfance. Ces exemples permettent de comprendre pourquoi nous avons tous des cerveaux différents, y compris les vrais jumeaux.
Par conséquent les vieilles idées, qui prétendent entre autres que les femmes sont naturellement douées pour le langage ou que les hommes sont naturellement doués pour faire des maths, sont complètement caduques. » (Les Quotidiennes, Catherine Vidal : Femmes, hommes – avons-nous le même cerveau ?, propos recueillis par Adrien Chevalley).
Toujours selon le CLER:
» L’ancrage biologique dans la construction identitaire signifie une certaine relation du sujet à son corps, une appropriation de celui-ci, qui passe par le consentement à ses potentialités comme à ses limites. Il y a également une symbolisation à partir du vécu sexuel féminin ou masculin qui débouche sur une différence dans la manière de désirer, de jouir, d’enfanter … Les représentations symboliques sexuelles jouent un rôle primordial dans la construction de la personnalité, de la personne intérieure. »
Cet argument parait assez confus: ce n’est pas parce que le vécu sexuel est vécu en relation à son corps que celui-ci est saisi de manière immédiate dans son essence biologique, sans recours à la discursivité du langage et au cortège d’interprétations et de représentations a priori qu’il véhicule. J’y reviendrai dans la dernière partie de ce billet.
» L’esprit humain se forme à partir du corps. Si le corps humain est différent entre les sexes comment l’esprit ne le serait-il pas (on n’a pas la même vision du monde quand on mesure 1,90 m et pèse 100 kg, que quand on mesure et pèse deux fois moins). Pourquoi serait-ce différent a priori pour la différence sexuelle ? »
La prise en compte discursive du corps, à partir des représentations propres à une culture et à une époque (ainsi la corpulence peut-être interprétée, chez les femmes par exemple, comme un signe de bonne santé et de vitalité, ou bien de laisser aller et de difformité). pour autant, les corps sont aussi divers qu’il y a d’individus: le rapport immanent (mais est-il si immanent que ça) au corps ne suffit donc pas à légitimer une partition binaire des potentiels et des attributs de chaque personne en fonction des deux sexes.
En fait, dans la mesure où les études de genre ont aussi pour elle des arguments qui viennent des sciences de la vie, je ne crois pas qu’opposer la recherche biologique à celle en SHS soit un angle d’attaque complètement pertinent.
Pour citer la blogueuse féministe Anne-Charlotte Husson:
« Je signalais également dans mon post précédent l’un des arguments principaux que l’on peut opposer à cette accusation de non-scientificité. Il se fonde sur l’héritage de la théorie féministe qui a montré, depuis plusieurs décennies, les limites de la prétendue objectivité des sciences exactes. Ces recherches ont eu une conséquence bien précise: elles ont fourni une base épistémologique solide à la critique des recherches sur les différences sexuelles et leur origine supposée dans le patrimoine génétique et le cerveau. Judith Butler souligne que « nombre de chercheuses féministes se sont intéressées à la biologie et à l’histoire des sciences pour analyser les intérêts politiques sous-jacents aux différentes procédures discriminatoires qui établissent les bases scientifiques du sexe » (Trouble dans le genre, note p. 68, trad. C. Kraus).
Dans Delusions of Gender. The Real Science Behind Sex Differences, Cordelia Fine mène une analyse très fine et extrêmement documentée du discours scientifique prédominant à l’égard des différences sexuelles. Elle montre notamment que les recherches dans ce domaine sont la plupart du temps faussées par leur présupposé de départ, à savoir, qu’il existe bel et bien des différences, dont il s’agira de montrer l’origine neurologique pour justifier, en retour, tous les mécanismes de différenciation genrés qui marquent la vie des individus depuis leur naissance. Elle explique ainsi que les recherches visant à prouver l’existence de ces différences sont beaucoup plus porteuses, en termes de carrière et de possibilités de publication, que les recherches visant à montrer que ces différences sont soit inexistantes, soit minimes en comparaison des ressemblances entre les sexes. La recherche scientifique (et on ne parle pas de sciences molles, attention, mais de choses sérieuses, avec IRM, graphiques et tout) contribuerait ainsi à corroborer et à figer les stéréotypes qui déterminent notre vision du monde et nos interactions avec les autres » (Genre! Etudes de genre et sciences « exactes »)
Ce bref commentaire d’un extrait de l’avis du CLER effectué, qui j’espère, permet de prendre conscience des insuffisances et des lacunes de cette tentative, au demeurant tout à fait louable, de prendre de la hauteur et d’insuffler de la sérénité au débat, venons en donc au vif du sujet:
Celui-ci se trouve évoqué par le CLER à un autre endroit de son avis:
« La réalité biologique des sexes jouant pour la théorie queer un rôle accessoire, le moteur principal de l’acquisition d’une identité et d’une orientation sexuelle est le contexte social et culturel dans lequel est élevé l’enfant. Les théoriciens du gender vont s’approprier la notion, issue des observations scientifiques, que la personnalité sexuelle émerge de la conjugaison des données biologiques et du contexte culturel et social dans lequel se développe l’individu. Mais ils vont se l’approprier à leur façon, grâce à un glissement sémantique du type « tout passe par le langage », ce qui peut être vrai, à « tout est langage », ce qui est faux. Ainsi, si toute représentation de la sexualité passe par la culture, il n’y a qu’un pas à franchir pour survaloriser cet aspect construit et culturel et relativiser la dimension biologique. Et un pas de plus pour arriver à exprimer que toute la sexualité est culturelle et sociale.
Que fait-on de la réalité de la différence biologique des sexes ? On ne peut la supprimer. Alors, tout simplement, on l’ignore, on la met hors-jeu, comme non opérante en dehors de la reproduction. »
Je pense qu’il y a là un vrai contresens sur les études de genre en général et la pensée de Judith Butler en particulier.
Il ne s’agit pas « d’ignorer » la réalité biologique par le biais d’un contructivisme linguistique radical, mais de partir du constat de la précarité et de l’abjection de certaines formes de réalités biologiques. Certaines formes de corps nous sont ainsi présentées comme « normales », et d’autres comme « anormales ». Souvent, cela est lié à des impératifs fonctionnels pour vivre en société de manière à peu près autonome. Ainsi (l’exemple n’est pas de Butler mais de moi) un aveugle ne pourra pas faire tout ce qu’un voyant fera, et en souffrira de manière pour ainsi dire constitutive, puisqu’il aura du mal à se déplacer seul, à avoir accès à un certain nombre d’informations, etc. Mais il existe d’autres types d' »anormalités » pour lesquelles il est plus difficile de comprendre pourquoi elles sont exclues de la norme par la perception commune: en quoi par exemple un intersexués par exemple, ou bien une personne qui se sent femme dans un corps d’homme ou vice-versa, souffrent d’un handicap par rapport aux personnes « normales? Qu’est-ce qu’elles ne peuvent pas faire que « tout le monde » peut faire? En quoi souffeent-elles d’un déficit d’autonomie ou de jugement, à la manière dont le handicap d’un aveugle ou d’un schizophrèen peut le mettre en danger? De même, pour ce qui est des corps « normaux », pourquoi un corps de femme est-il perçu comme plus fragile, ou plus gracieux, q’un corps masculin, alors que les jeux olympiques féminins n’arrivent pas à établir des critères absolument certains de différenciation sexuelles, dans leurs procédures de contrôles, et que les contre exemples d’hommes fragiles et/ou gracieux et de femmes « viriles » et/ou athlétiques abondent? En raison d’un constat statistique, parce qu’il est tout de même « beaucoup plus courant » de croiser des fmmes « féminines » et des hommes « masculins » que l’inverse? C’est alors l’habitude qui donne sa force d’évidence à la différence des sexes: nous partons du principe qu’ils sont différents, parce que nous avons l’habitude de voir des différences entre eux, et plus celles-ci semblent se répéter, plus facilement nous en déduisons qu’elles participent d’ue sorte d’essence de la féminité ou de la masculinité, qu’elles sont issues d’un déterminisme biologique et non pas social.
Or, si notre regard sur les corps, sur ce qui constitue la différence entre leur essence « biologique » et les conditionnements sociaux qui se surimposeraient éventuellement par dessus, est informé par l’habitude, cela signifie que notre regard sur eux n’est pas naïf et immédiat, comme si nous les observions pour la première fois, mais que nous avons des attentes préétablies à leur intention, qui viennet de ce que nous avons « toujours » ou « d’ordinaire » vu, sur ce que nous avons entendu dès notre plus tendre enfance sur ce qu’est être une fille et est être un garçon, etc.Notre conception de la différence des sexes est en quelque sorte préremplie par des discours qui sont liés aux usages et aux habitudes. C’est en ce sens que Judith Butler, par exemple, considère que notre rapport aux corps et aux différences biologiques (auxquelles elle ne dénie pas tout fondement), est de nature « discursive », c’est à dire qu’elle est conditionnée par un discours que nous nous sommes approprié par la répétition des observations semblables et des usages, et donc par le langage. C’est en ce sen squ’elle écrit, dans l’extrait que je citais dans mon avant-dernier billet sur ce blog:
« Certaines formulations de la position constructiviste radicale semblent provoquer presque irrésistiblement un moment d’exaspération: de façon récurrente, le constructiviste est perçu comme un idéaliste linguitique, il parait dénier la réalité des corps, la pertinence de la science, les faits supposés irrécusables de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le critique pourra alors suspecter le constructiviste d’une certaine somatophobie, et cherchera à s’assurer que ce théoricien abstrait admet, au moins, qu’il y a des organes sexuellement différenciés, des différences dans les activités et dans les capacités, des différences hormonales et chromosomiques qui peuvent être reconnues sans qu’il soit fait réfrence à la « construction ». Bien qu’à cet instant je veuille absolument rassurer mon interlocuteur, une certaine anxiété prend le dessus. « Concéder » l’incontestabilité du « sexe » ou sa « matérialité », c’est toujours accepter une certaine version du « sexe », une certaine formation de la « matérialité ». Le discours à travers lequel intervient cette concession – et, oui, cette concession intervient invariablement – ne contribue-t-il pas lui même à constituer le phénomène qu’il reconnait? Affirmer que le discours est formateur, ce n’est pas prétendre qu’il est à l’origine de ce qu’il reconnait, qu’il en est la cause ou qu’il le compose entièrement; c’est plutôt dire qu’il ne peut y avoir de référence à un corps pur qui ne participe pas à la formation de ce corps. En ce sens, il ne s’agit pas de nier la capacité linguistique de se référer aux corps sexués, mais de modifier la signification même de la « référentialité ». En termes philosophiques, on pourrait dire qu’il n’est pas de constat qui ne soit, dans une certaine mesure, performatif. »(Judith Butler, Ces corps qui comptent: de la matérialité et des limites discursives des « sexes », Editions Amsterdam, 2009, traduit par Charlotte Nordmann, p. 23 à 26).
Bien sûr qu’il y a des différences biologiques ultra majoritaires entre chaque sexe, bien sûr qu’elles constituent des réalités concrètes qui différencient ce que peuvent ou non faire, d’habitude, les hommes et les femmes, mais notre regard sur ces différences est tellement, à l’usage, conditionné par l’habitude et par l’anticipation par celle-ci de ce qu’est un corps de femme et de ce qu’est un corps d’homme, et des effets qu’ils sont censés produire, qu’il est est quasiment impossible de faire la part des choses de manière certaines entre la part du biologique et la part du construit culturel.
C’est pourquoi en dernière analyse la position « modérée » qui vise à concilier les positions essentialiste et constructiviste en distinguant entre un certain nombre d’évidences biologiques, et un certain nombre de conventions sociales elles-mêmes souvent faciles à percevoir, n’est en définitive pas acceptable, puisqu’elle prétend accéder sans médiation à une évidence du biologique qui est constamment antcipée par l’habitude et la répétition des « évidences ». Comme le rappelle en effet, dans l’extrait cité plus haut, Anne-Charlotte Husson, à propos des recherches de Cordélia Fine, mmême les biologistes les plus éminents peuvent voir leurs observations faussée par l' »évidence » préattendue de la différence des sexes.
D’où la remarque de Judith Butler, toujours dans le même passage:
« Le critique « modéré » concèdera peut-être qu’une certaine partie du sexe est construite, mais il soutiendra qu’il en est une autre qui ne l’est certainement pas. Il se trouvera alors bien sûr dans l’obligation de tracer la frontière entre ce qui est construit et ce qui ne l’est pas, mais aussi d’expliquer comment il se fait que le « sexe » soit constitué de parties dont la différenciation ne relève pas de la construction. Mais lorsqu’on établit cette ligne de démarcation entre parties ostensiblement distinctes, le « non-construit » se retrouve à nouveau déterminé par le biais d’une pratique de signification, et c’est la frontière censée garantir une partie du sexe de la contamination du constructivisme qui est maintenant définie comme la construction de l’anti-constructiviste lui-même. La construction est-elle quelque chose qui arrive à un objet déjà constitué, à une chose donnée, et arrive-t-elle par degrés? Ou nous référons-nous, des deux côtés, à une inévitable pratique de signification, de démarcation et de délimitation de ce à quoi nous nous « référons » ensuite, de telle sorte que nos « références » présupposent toujours – et masquent souvent – cette délimitation première? En effet, pour se « référer » naïvement ou directement à un tel objet extra-discursif, il faut toujours préalablement délimiter l’extra-discursif. Et dans la mesure où l’extra-discursif est délimité, il est formé par le discours même dont il cherche à se libérer. Cette délimitation, souvent accomplie comme une présupposition non théorisée dans tout acte de description, marque une frontière qui inclut et qui exclut, qui décide pour ainsi dire de ce qui constituera la substance de l’objet auquel nous nous référons ensuite. Cette démarcation est porteuse d’une certaine force normative et en même temps d’une certaine violence, car elle ne peut construire qu’en effaçant; elle ne peut circonscrire une chose qu’en imposant un certain critère, un principe de sélection. »
Il n’est en effet beaucoup moins facile de définir ce qui constitue la réalité biologique « indiscutable » des corps aux fondements de différences telles que celles entre les sexes que d’affrimer qu’elle existe, et la difficulté qu’ont les comités de sélections de jeux olympiques à définir des critères fiables de différenciations entre sexes, que j’exposai dans un précédent article, le montre bien. Cela met le catholique modéré en posture de devoir déterminer lui-même des critères de démarcation entre le biologique et le culturel, et entre les sexes, qui sont finalement fondées sur l’habitude et non sur une quelconque évidence « immédiate », et ainsi toujours susceptibles de rencontrer des exceptions et de reléguer des personnes vivantes dans l’anormalité, la monstruosité, et l' »abjection ».
http://aigreurs-administratives.blogspot.fr/2013/06/les-catholiques-moderes-face-aux-etudes.html?spref=tw