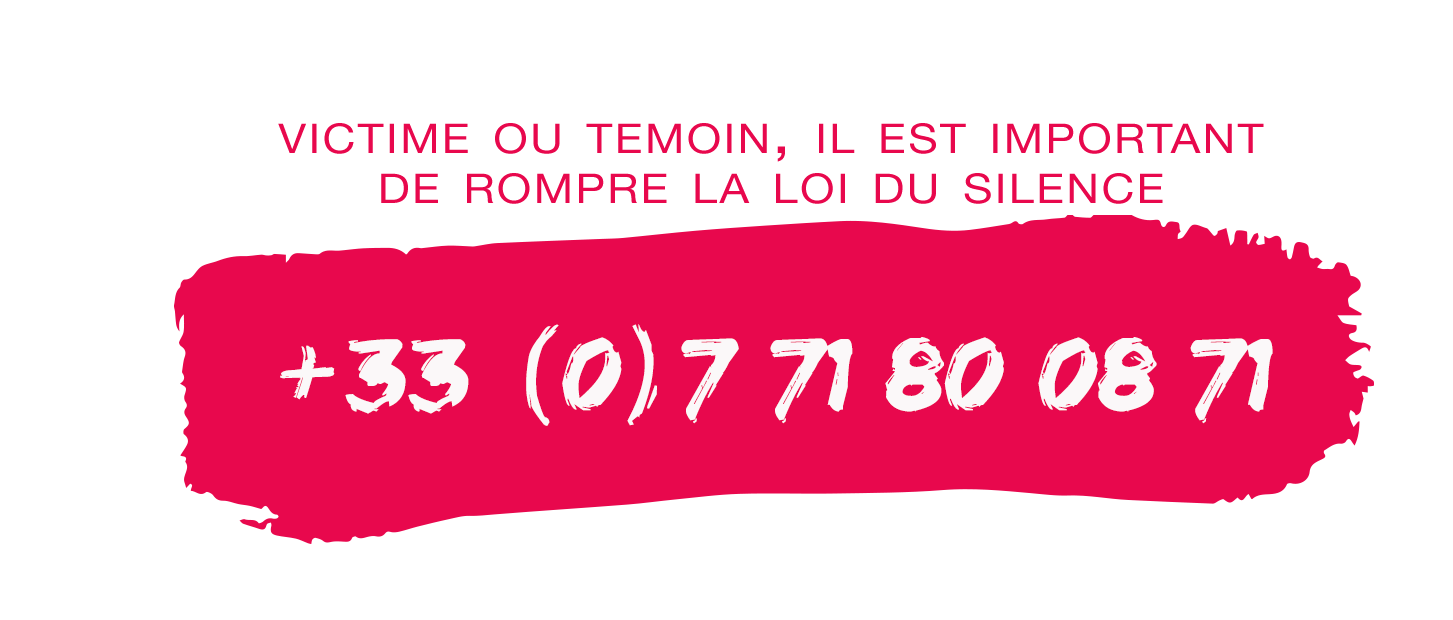À la suite de la décision de la Cour suprême britannique qui redéfinit légalement la notion de femme selon des critères strictement biologiques, Marie Cau – première maire transgenre élue en France – livre une tribune percutante. Elle y analyse les limites scientifiques et éthiques d’une telle approche, qui, sous couvert d’apaisement, pourrait bien attiser davantage les tensions autour des droits des personnes transgenres et intersexes. En pointant l’ambiguïté du concept même de « sexe biologique », elle alerte sur les dérives possibles d’une vision réductrice de l’identité humaine et plaide pour un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La Tribune
Dans une décision très attendue, la Cour suprême du Royaume-Uni a statué que, d’un point de vue légal, une femme est définie selon son sexe biologique, et non selon son genre. Un jugement qui se veut équilibré dans un débat profondément clivant, mais qui risque, selon plusieurs observateurs, de ne faire que repousser une confrontation inévitable.
Le cœur du problème réside dans le flou autour de la notion de « sexe biologique ». Car si la reproduction sexuée repose effectivement sur une binarité (mâle/femelle), la sexuation — c’est-à-dire l’ensemble des processus biologiques, neurologiques, hormonaux et génétiques qui façonnent l’identité sexuée d’un individu —, elle, est loin d’être aussi simple. La décision de la Cour, bien qu’empreinte de prudence, n’apporte pas de définition claire de ce qu’est le « sexe biologique », notion qui peut inclure des critères aussi variés que le génotype, le phénotype, la présence ou l’absence d’organes reproducteurs, ou encore le fonctionnement cérébral.
Ce flou n’est pas propre à la justice : les grandes instances sportives internationales, qui se sont elles aussi confrontées à la nécessité de définir des critères d’éligibilité dans les compétitions féminines, n’ont pas su apporter de réponse satisfaisante. Faute de mieux, elles se sont souvent rabattues sur un seul indicateur : le taux de testostérone. Une mesure certes tangible, mais extrêmement réductrice, notamment dans le cas des femmes intersexes ou présentant une hyperandrogénie naturelle. Ces athlètes se retrouvent ainsi stigmatisées ou exclues sur la base de données hormonales qui ne reflètent pas la complexité de leur identité ni de leur physiologie.
En outre, réduire une personne à ses seuls attributs biologiques pose un problème de fond. Nombre de scientifiques s’accordent à dire que l’identité sexuée d’un individu ne se résume pas à ses organes, mais dépend aussi de son cerveau, de son fonctionnement hormonal, de son orientation sexuelle et de son identité de genre. À ce titre, une femme transgenre n’est en aucun cas une « femme synthétique » : son vécu, son identité, son parcours médical et social font partie intégrante de sa réalité humaine.
Si la Cour suprême cherche, à la manière du roi Salomon, à ménager les antagonismes dans un débat miné, elle ouvre potentiellement une boîte de Pandore. En statuant sans réellement définir ce qu’est le sexe biologique, et en se reposant sur une conception strictement biologisante de l’identité, elle risque d’encourager des lectures rigides, voire dangereuses, du droit. L’Histoire a montré les dérives possibles de classifications biologiques : racisme scientifique, eugénisme, discriminations systémiques… autant d’idéologies qui vont à l’encontre des principes universalistes chers aux démocraties européennes.
Il apparaît désormais crucial de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière, dont la jurisprudence fait primer la notion de genre sur celle du sexe assigné à la naissance, pourrait contrecarrer l’approche conservatrice de la juridiction britannique. Faute de quoi, le risque est grand de voir se multiplier les contentieux et les jurisprudences contradictoires, au détriment des personnes transgenres et intersexes, mais aussi de la clarté juridique nécessaire à toute démocratie.
En fin de compte, si la Cour suprême est bien dans son rôle en disant le droit, elle outrepasse peut-être ses compétences en tentant de fixer les contours d’un concept – le sexe biologique – que même les biologistes peinent à enfermer dans une définition unique. Ce débat, éminemment complexe, nécessite une approche scientifique, éthique et humaine à la hauteur des enjeux.